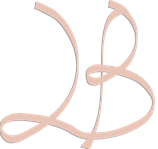Toute somme reçue du défunt doit être rapportée à la succession de son auteur, à moins qu’il ne s’agisse d’un don d’usage.
Dans le cas présenté, l’une des filles de la défunte s’était permise d’émettre des chèques du vivant de sa mère, chèques libellés à son ordre ou à celui de ses proches. En défense, elle arguait de présents d’usage ou d’une rémunération pour services rendus. Le tribunal judiciaire du Havre ne l’a pas suivie dans son argumentation.
Jugement du 11 juillet 2024, Tribunal Judiciaire du Havre :
Extrait du jugement :
- Sur la demande de rapport à la succession :
Il convient de rappeler que le droit français, qui encadre les règles de succession, pose l'égalité entre les héritiers comme principe fondamental, c'est-à-dire, à défaut de testament, la répartition équitable des biens entre les différents héritiers en fonction de leur lien de parenté avec le défunt, et non en fonction de leur présence ou non auprès de lui. Ainsi la défenderesse ne peut revendiquer son rôle exclusif auprès de sa mère pour faire obstacle au principe de l'égalité entre les héritiers.
Le respect de l'égalité entre les héritiers est assuré par les actions de rapport à la succession de l'article 843 du code civil. Aux termes de cet article, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Aux termes de l'article 852 du même code, les présents d'usage ne doivent pas être rapportés ; le caractère du présent d'usage s'apprécie à la, date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant.
Il s'ensuit que toutes les libéralités entre vifs directes ou indirectes sont par principe présumées rapportables, excepté le cas particulier des présents d'usage sauf volonté contraire du disposant.
En l'espèce, les demandeurs produisent la copie de 25 chèques débités du compte de leur mère entre le 31 mars 2017 et le 2 janvier 2020, au bénéfice de leur sœur défenderesse ou de membres de sa famille.
Cette dernière a indiqué au notaire qu'il s'agissait de présents d'usage ou de rémunération pour services rendus.
Cependant, le tribunal prend acte, tel que l'a écrit la défenderesse au notaire que 9 chèques portent une signature qui n'est pas la sienne, mais qui est une imitation de la signature de la défunte ; ils sont tous libellés à l'ordre de son époux. Ces chèques portant imitation de signature ne peuvent correspondre à la volonté réelle de la défunte et en conséquence représenter des présents d'usage et/ou des rémunérations pour services rendus ; compte tenu de ce que le bénéficiaire de ces chèques est le conjoint de la défenderesse, il convient de considérer qu'ils ont profité directement ou indirectement à cette dernière, de sorte qu'en vertu de l'article 843 susvisé, la somme correspondante de 7.000 euros sera rapportée à la succession.
Les 16 autres chèques portent une même signature dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de celle de la défenderesse et sont libellés à l’ordre d’elle-même ou des membres de sa famille pour un total de 40.000 euros. Il résulte des pièces des demandeurs que pendant la période de l’émission des chèques litigieux, leur mère était hébergée en EHPAD et plus particulièrement en unité de soins de longue durée jusqu’à son décès. L' argument d'un paiement pour services rendus est donc peu convaincant puisque la mère de la défenderesse n'était plus à son domicile depuis juin 2015 et ne nécessitait aucun service particulier des membres de sa famille, d'autant que les services prétendus ne sont pas démontrés. Par ailleurs, l'argument relatif aux présents d'usage ne peut davantage prospérer pour les chèques suivants (énumération des chèques), en l'absence d'éléments constitutifs pouvant les caractériser, étant rappelé que la jurisprudence constante les définit comme des cadeaux faits à l'occasion de certains évènements (fêtes de Noel ou de Pâques et les anniversaires) n'excédant pas une certaine valeur. Le tribunal ne retient pas pour les chèques susvisés la qualification de présents d'usage, et dit qu'en conséquence, la somme de 40.000 euros doit être rapportée à la succession.
Il résulte des pièces du dossier que le solde de l'actif successoral est de 18 500 euros, tel qu'établi par le Notaire.
Le principe d'un rapport fictif à la succession de sommes susvisées est donc insuffisant pour rétablir l'égalité entre les cohéritiers, la défenderesse ayant perçu une somme supérieure à sa part dans le partage. Il est donc nécessaire de condamner la défenderesse à restituer la part qui revient à ses cohéritiers. Il appartiendra au Notaire d'établir les comptes entre les parties, après calcul de la masse active nette, et de déterminer la somme que la défenderesse devra restituer à ses cohéritiers.